Le diagramme de Hertzprung-Russel actuel
Les caractéristiques des étoiles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Il existe des relations entre la masse, la luminosité, le rayon, la température des étoiles.
Le diagramme HR, permet de retrouver les principales caractéristiques des étoiles
Température de surface des étoiles ou Type spectral (en abscisse)
Luminosité des étoiles (en ordonnée, exprimé en rapport de luminosité L/Ls ou en Magnitudes Absolues)
Diamètre des étoiles (voir le § 'isorayons stellaires')
Distance des étoiles (Voir le § 'parallaxe spectroscopique')
Masse des étoiles (Voir le § 'relation masse luminosité')
Durée de vie des étoiles (Voir le § 'Durée de vie des étoiles')

1000000
VI
VII
Classes de Luminosité :
Classe 0 : Hypergéantes (Rares LBV)
Classe Ia : Supergéantes lumin.
Classe Ib : Supergéantes
Classe II : Géantes lumineuses
Classe III : Géantes
Classe IV : Sous-géantes
Classe V : Séquence principale (naines)
Classe VI : Sous naines (peu utilisée)
Classe VII : Naines blanches
Classification de Harvard :
Type spectral Température Etoiles remarquables
O : Etoiles bleues > 25 000 K Delta Orionis
B : Etoiles bleues-blanches 10 000 à 25 000 K Rigel, Régulus, Spica
A : Etoiles blanches 7500 à 10 000 K Deneb, Sirius, Vega
F : Etoiles Jaunes- blanches 6000 à 7500 K Polaris, Procyon A, Canopus
G : Etoiles jaunes 5000 à 6000K Le Soleil, Capella
K : Etoiles jaunes-oranges 3500 à 5000K Arcturus, Aldébaran
M : Etoiles rouges < 3500K Proxima centauri (naine rouge),
Bételgeuse, Antares (Géantes rouges)
Une synthèse des caractéristiques et abondances des populations d'étoiles de chaque type spectral
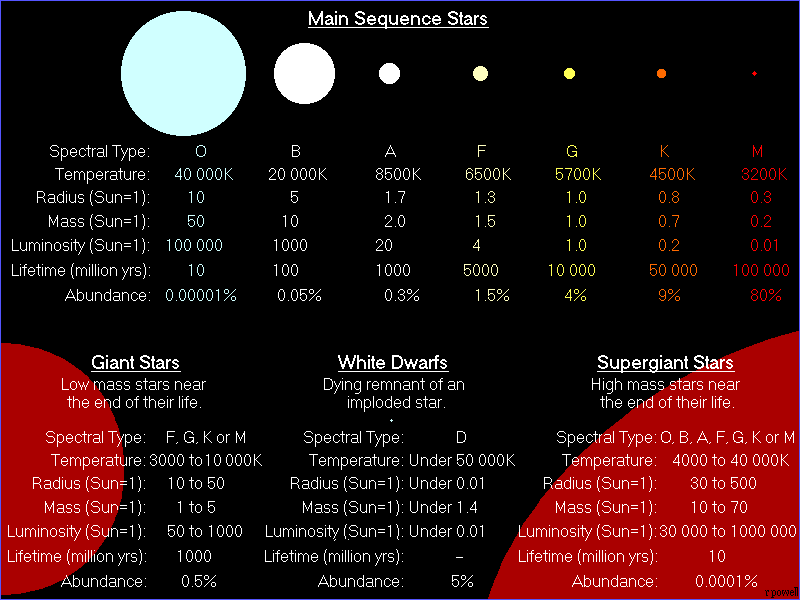
Exemple de libellé d'un type spectral
Capella Aa est une étoile géante jaune de type spectral G5 IIIe :
Type spectral dans la classification de Harvard : G (Jaunes) ,
Sous-type spectral : 5
Classe de luminosité : III (Géantes)
Particularité : e (présence de raie spectrale en émission)
Quelques exemples de particularités spectrales :
Comp : Le spectre se superpose avec une autre étoile non résolue
Var : Etoile variable
e : Raies d'emission dans le spectre
m : Raies métalliques fortes
n : Rotation rapide
p : Particularité spécifique non précisée.
....
Autres types spectraux
Etoiles carbonées (Carbon star) :
Types spectraux R, N , C : Etoile carbonées. Présence de bandes de la molécule de carbone.
Type spectral S : Présence des bandes de l'oxyde de zirconium..
Etoiles Wolf-Rayet - WR :
Types spectraux WC, WO et WN :
Etoiles Wolf Rayet, étoiles de type O très chaudes de 35000K à 100000K montrant le spectre d'émission de l'Hélium neutre et ionisé.
Pour les types WC et WN apparaissent les raies d'émission du carbone et de l'oxygène,
Pour le type WN celles de l'azote ionisé plusieurs fois.
Naines Blanches :
Principaux types spectraux :
DA : Présente les raies de la série de Balmer
DB : Présente les raies de Hélium neutre He I
DO : Présente les raies de l'Hélium ionisé une fois He II
DC : Continum sans raies bien marquées
DQ : Raies du Carbone atomique ou moléculaire
DZ : Autres éléments présents
Naines brunes (Brown Dwarf) - objets substellaires :
Types spectraux L, T, Y
Type L :
Fortes raies de metaux hybrides (FeH, CrH, MgH, CaH), et alcalins (Na I, K I, Cs I, Rb I).
Température inférieure à 2400K
918 naines de ce type recencées fin 2012
Type T :
Les spectres des naines brunes, très froides, se caractérisent par des bandes moléculaires comme dans nos planètes gazeuses (CO, Méthane CH4, H2O, Hydrogène moléculaire H2) .
Température inférieure à 1400K
355 naines de ce type recencées fin 2012
Type Y (Sous- naines brunes).
15 exemplaires recencés fin 2012, en cours d'études. Le critère entre planète gazeuse et sous naine brune est déterminé par la masse et non le type spectral. Il est difficile d'estimer la masse de ces objets isolés.
Leur température est inférieure à 500K.
D'après un article de Danielle Briot et Anne-Lise Maire sur l'Astronomie d'Avril 2014

Les naines brunes ont une masse insuffisante pour entretenir la fusion de l'hydrogène en leur coeur.
En dessous de 13 Mjupiter : pas de fusion du coeur de l'objet.
13 à 65 Mj : Fusion du Deutérium
65 à 75 Mj : Fusion du Lithium
Au-delà de 75 Mj : Fusion de l'hydrogène, naines rouges
Crédit : Dossier Pour la Science - 'Vie et Moeurs des étoiles' - Hors série Janvier 2001
Durée de vie des étoiles
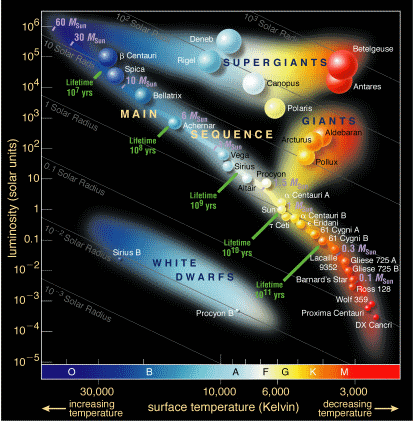
Les étoiles de la séquence principale ont une durée de vie extrèmement variable.
Voir les graduations vertes sur la séquence principale en années (yrs) .
Plus la masse des étoiles est grande, plus leur durée de vie est courte :
Les plus petites naines rouges (Masse de 0.08 Ms) ont une durée de vie estimée à 1500 milliards d'années.
Le Soleil a une durée de vie estimée à 10 milliards d'années
Les géantes bleues ont une durée de vie très courte de l'ordre de 10 millions d'années seulement.
